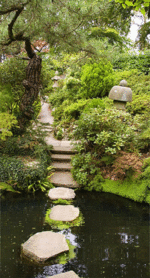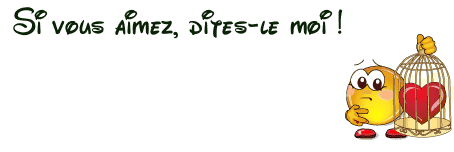-
MES POEMES
-
Par Blagassou le 8 Octobre 2014 à 21:22
TROP-PLEIN DE SANG
Et de nouveau les grands pluriels dilatèrent le cercle bleu des aventures
Le grain fin d’aventure glissé dans mes rouages put conter son histoire en toute humilité
Des goélands d’ivresse planent sur les galères Ebahis du miracle emporté sur leurs ailes
La musique en est au jour de création de l’homme
Et les îlots d’arpèges où danse le mât d’une clarinette remuent la mémoire enfouie
Ce qui m’use ce sont tous ces pays de mots traversés et la crête invisible d’une future épreuve de glaces
Ce qui vieillit l’immobile explorateur de cadences c’est le va-et-vient des vents harnachés de missives sur sa face exposée à tous les ruissellements de rayons et de pluies
Ma respiration échange avec le monde des kilomètres d’aventures
Et voici mon poème alentissant son regard sur les steppes fauves de la pérennité
D’où part –dis-tu – la sève qui fleurit là-haut les névés ? Jusqu’où se gravent les racines de ta joie ?
C’es vouloir compter des nuages toutes les causes toutes les sources toutes les mers
Et tous les fours errants des vents d’argile qui les captent
Ma montagne est une acrobatie sans filet sur la stupeur des lacs les doubles de ses cascades
Mon amour est le plateau du geyser quand la femme sereine du ciel s’y couche nue et s’y endort
Après que le soleil eût repeint d’azur la lèpre de ma cellule ma bouche aux gestes titubants d’un nouveau-venu sur ses deux jambes modula les syllabes du miracle – le nom donné à tout ce qui ne nous appartient pas –
Et toute ma frénésie d’expression ne fit pas davantage que l’appel rauque de la poulie lorsqu’elle hissa jusqu’à la margelle du puits mes larmes
Mon ami comme il faut que tu m’aimes pour accepter ce viol consenti de mon âme par la paume lente du poème pour t‘effacer devant ces manigances amoureuses avec le verbe pour ne me prendre qu’à la faveur d’une alerte au maquis brûlé des consonnes
Mais ne crains rien pour le timon je ne tire pas à dia notre attelage file droit dans les reliefs qui se présentent et l’effort d’une image ne freine pas notre voyage le vent nous gaine avec l’amour de son métier et moi je me laisse être celle que tu aimes écrivant sous ton œil ami le souvenir encore chaud de la litière calme le confluent souterrain de nos deux rivières après leurs jeux diurnes dans les champs de flammes
Rien ni force ni rage ni patience ne changea d’un iota le nombre calculé de mon attente
A l’heure dite me vinrent ces mots raisins jetés en cascade de la corbeille et déroulant leurs ambassades jusqu’aux angles de la cuisine
Et l’image passe avec la simplicité des saisons
Je feignis d’ignorer la poésie comme un grand courage auquel on n’est pas prêt jusqu’à ce qu’un loriot joaillerie savante épinglée sur le revers sobre du crépuscule me redonnât le goût d’un luxe à conquérir
Duel de sources qui se captent Pentes enjôleuses du juste et de l’injuste Pic du tournoi ô couronné je t’ai gravi pour assister de haut à la guerre des cimes pour apprendre comment les fleuves s’initient
Je m’essaie au déluge des ères et des nations Aux cycles enroulés des cuscutes évolutives Aux noblesses des pluriels et des mystères syllabiques posés en voile sur les crudités de la genèse
Je m’initie au souffle des fleuves et des yogis Je stratifie l’intelligence du monde de la nue à la radicelle du magma du noyau au vide qui s’enroule
Je m’exerce à constater l’orbe inaudible des soleils et des abeilles
Je bois à coupe ronde la Géographie Sobre encore hier je m’enivre vite à la seule goutte de cobalt de la Floride Au fumet d’étable du Bosphore Au rubis liquoreux de l’Afrique Au buisson ardent d’Hawaï Aux équilibres nasillards antipodiques de la Chine
J’additionne les suspens et les certitudes Les cristaux et les mammifères Les mareyeurs et les prêtres à l’image des grands mais calculables inachèvements cosmiques Chaque jour le torse barré des trois couleurs unit hier à demain qui promettent d’infléchir le plateau des longues statistiques
Tu ne peux pas te souvenir Le soleil dansait sur les grands quadrillages géodésiques et la perche oscillante des jours et des nuits le balançait entre les pôles Et les dociles projecteurs nouaient avec lui les mêmes boucles périlleuses privant de clarté toute une orbe attentive lui concédant parfois la seule lunule claire d’un reflet
Le poème court vomit et déblatère et ce soir retourne à la saoulerie
Tout progresse avec des retours de vagues et de cigognes avec des pruines des patines des hibernations des fausses morts dans des cercueils nématoïdes
Le poème cache bien son squelette jusqu’à sa mort Le poème me danse autour Le poème à la seconde où l’once de chair brûle qui me séparait de la mort Le poème me coupe le souffle par le seul jeu de
l’inégal
La vie seule a droit de fatras A droit de se tromper d’électrodes jusqu’à la mort La vie peut tout mêler peut tout singer peut tout signer des tables crétacées du silence du cormoran au ventre courbe aux artères volubiles de la machinerie humaine
Les canaux qu’on a démuselés d’écluses
Les sources qu’on a épargnées dans un bas de montagne jusqu’à la gerbe de tumulte et d’éclairs
Les criques qu’on a soudoyées de bombes
Et les feux d’artifices lacustres les nuits de festival
Et les gaz souterrains chuintant dans le silence régulier des dormeurs la mort infusée sans bruit dans leurs poumons
Et les bouchons cachés des goulots en sillage de mousse
Le volet claqué du harangueur paranoïaque au-dessus des foules matinales qu’il ne dénombre plus
Et les fleuves opulents brasseurs de fonds et de reflets
Où flottent des houillères et des fûts de résine –
et sur le dos un nageur blond faisant sa sieste
un caramel noir de feuilles aux commissures de leur sexe
une vomissure de marne à leur bouche
et les débardeurs bleu goudron patinés de sel et leurs cirés depuis le train
hauts-fourneaux sémaphores
dans la nuit éraillée d’amour et de voirie
et l’océan qui rue sous l’éperon aigu des brisants et des angles d’épaves
et le sperme fouisseur jusqu’à l’ombelle fugitive
et la sève brûlante soufflée tulipe de cristal à l’embout de la sarbacane
la langue sèche des tourniquets peignant les nougats et les poupées foraines
et les manèges avec leurs disques contrariés Et les tornades
et la valse lente de fumerolles pensives
Tu ne peux pas te souvenir
Salicorne agrippée comme un poil à l’aisselle du delta
Glanure du voyage qui germe après de longs hivers
Chaque ballon respiré serre un poisson une couleur pour les famines ou cécités futures
La liberté siffle dans l’écho
Insecte arc-bouté et qui retombes
Tu ne lui pardonnes pas de nicher si haut
La liberté transmet la chasse à ses enfants qui se passeront d’elle Ces grappes de souvenirs qui me lestent me sont espoir de monter encore Ces laisses sociales me sont autant d’électrodes qui me lardent
Echeveau des contraintes
Peloton des logiques
Et le pointillé des fulgurances
Et l’aïeule devinant mes fourmis impatientes préféra fermer le livre et glisser seule vers les plages douces de la lenteur
Hélène Aribaut
Encres Vives n° 67 Automne-Hiver 1969
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 8 Octobre 2014 à 21:24
Poème très long parce qu'il est une compilation de plusieurs poèmes!
MES ARBRES
L'arbre le plus beau celui
dont les caprices de branches furent autant d'obstacles rencontrés
contournés ou franchis
autant de vents contraires ou de souffrances
ou la volonté sensuelle de l'arboriste zen
Le poète le plus vrai celui
que déchire chaque jour
Et il fait de ses traces sanglantes des hiéroglyphes pour rêver
Mon piano est un arbre venu de loin
qui a poussé longtemps sans savoir que dans ses veines d'acajou
viendrait chanter la grâce que j'appelle
Et ma table est un arbre où je viens mettre bas mes petits
écrire et pleurer, manger et vivre
rêver sans que les feuilles bougent
un arbre privé de vent mais vivant, toujours,
buvant comme une ambroisie le miel renversé par l'enfant,
accueillant la marée des choses de chaque jour
stylos, journaux, livres ( des arbres encore)
verres, tasses, fleurs, et les coudes des amis.
L'arbre est partout dans ma maison
apprivoisé
branche fleurie se réfractant dans le cristal,
bambou tressé, planche où l'on dîne, couvert à sauce chargé d'arômes
et ce saladier rond d'olivier d'Espagne
où sourd l'huile en lumière dorée.
Arbre percé de la flûte
Bateau-guitare
Faîte de l'arbre dans le ciel
l'élytre sonore de mon violon
Il s'est fait doux et domestique
mais aux jours de tempête il geint
répond à sa famille du dehors
Les grands troncs aux méandres profonds
les grands fleuves aux affluents mouvants sous la tornade
les bras levés haut dans l'imploration du ciel sous l'averse
et la chevelure ployée sous le faix du vent
les cyprès torses allumant sur la colline des brasiers noirs
la fourrure dense des pins à flanc de montagne
les sapinières noires aux fûts de cathédrale
où l'on pénètre voûté sous le poids des grandes orgues
dans l'encens capiteux de la résine
sur le tapis stérile des aiguilles avec
dans les trouées rougeoyantes du vitrail
l'exubérance folle et verte des fougères
et l'exquise fraise petite au goût violent
Et dans mon corps aussi je sens la sève pousser
ses rameaux bleus et rouges
La vie se ramifie vers la terre et le ciel
Et parfois
immobile et debout dans le soleil
les yeux fermés
le pouls à l'amble avec la terre
je me laisse remplir par la source qui monte et j'attends,
végétale, la volonté mystérieuse de la terre
sous mes pieds, de mes jambes dans la terre,
et de tentacules électriques révélés patiemment dans la lenteur de l'extase
lorsque mon faîte accepte la folie du ciel
et que mes bras écartés offrent à l'été les fruits de ma poitrine
le soleil les dore, la pruine les poudre
Mon poème est ce printemps aux tiges grêles qui promet déjà
l'horizon enflammé d'août, et octobre gravide
et bientôt pourriture
et plus tard nourriture pour le nouveau printemps
Mais je m'endors Je descends dans le rêve
Mes racines plongent profond chercher l'eau la plus pure
Par-delà les filtres sableux de la mémoire
Ma forêt ne s'enorgueillit pas d'essences rares
Il y règne la presque monotonie de la pinède sèche trouée de garrigues
les vagues furieuses des branches que le mistral anesthésie de tout parfum
ou bien, à l'heure moite de la sieste,
où seule et folle je m'écorche les mains d'une brassée de chardons bleus,
je promène mon visage à l'exacte croisée des fragrances
la résine lourde qui tombe sur les rocailles chauffées à blanc
l'alcool violent du thym qui vole à sa rencontre
et parfois les hampes grises des lavandes sauvages
ajoutent leur épice au breuvage de juillet
Les collines d'hiver
mes promenades amoureuses
Dans les forêts superposées du souvenir
fresques pâlies de la petite enfance
s'aligne l'allée de platanes dans la poussière de juin à la sortie de l'école
les châtons éparpillés
pompons défaits de soie ocre qui volent dans nos cheveux
la lèpre du tronc où je clugne
le placard de maman-confiture
et les bancs verts qui sentent l'urine et le clochard
Verdure domestique entre les grilles des jardins
massifs dessinés, arbres élagués portant au cou leur nom latin
déployant une ombre amie sur la loueuse de vélos d'enfants
jetant leurs feuilles sur la bâche verte du manège
dans le caillebotis des balançoires
On avait creusé des canaux pour le plaisir des passerelles
et trois jardins se donnaient la main
par leurs viaducs de dentelle
où coulaient des géraniums-lierres
Si je veux isoler un arbre
de sa gangue de terre et de vent
de l'humus de mes fantasmes il meurt
Si je veux isoler la terre
boule folle où tout se passe
ou poignée fusant entre mes doigts
il me reste
le vide entre les comètes ou bien
la toile serrée de ma paume
dont la tourbe restée accuse de noir tous les sillons
Mon poème court, ombre, devant moi ou me suit
et ramasse tout ce qu'il rencontre
parfois s'adosse à un cèdre
et ferme les yeux pour entendre la mélodie de son odeur
et quelquefois se couche à même le sol à écouter un pouls
le sien, celui de la planète, il ne sait
Plutôt rencontre de deux houles
confluent, embouchure ou ria indécise
duo mélange flux et reflux
Mais toujours appelé plus loin
ne sait ce qu'il cherche
il ne s'arrête
que sur les microcosmes
Le cerisier se laisse traire
La branche raide reconnaît la main et s'approche
Les doigts diligents pincent les feuilles
L'échelle vibre avec l'arbre
Au sommet tu es dans le vent
la cime végétale parcourue de vie et de sève
Tu te balances branche parmi les branches
la tête dans le ciel
Au jardin d'Eden poussaient des poémiers
et d'un seul geste expert
tu en délivrais des grappes rouges
Lien du film (1987) de Frédéric Back : L'homme qui plantait des arbres (sur un texte de Jean Giono dit par Philippe Noiret):
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 15:56
Oisive mémoire
Toujours accrochée
Aux vieilles histoires
Des choses passées
Dis-moi plutôt l'heure
Des claires demeures
Qu'un futur espère
En gouttes émues
En verts yeux de verre
Qu'aucun fil ne mue
Vers la ronde glace
Où l'esprit se lasse
Inverse les dates
Gravées sur la tour
La soeur délicate
Des tendres amours
A compris l'astuce
Et qui que tu fusses
T'aimait sans connaître
Ton nom ni ton âme
Quelle est ta fenêtre
Interdite aux femmes
Pour qu'un jour j'y ose
Un bouquet de roses ?
Que dit ton oreille
Des rimes câlines ?
Et que me conseille
L'instinct de ta mine ?
Laissons mes rimailles
Et rien ne te vaille !
Oisive mémoire
Toujours accrochée
Aux vieilles histoires
Des choses passées
Dis-moi plutôt l'heure
Des claires demeures
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 15:57
Vois : notre bulle ondule
Palpite…telle un tulle
Glacé
Et pâlit, puis se brise,
Passée.
Mais une autre plus belle,
Transparente ombelle
D’air pur,
S’enfle et s‘envole,
Subtile parabole
D’azur.
Ton souffle la fait fuir.
Hélas, elle va mourir
Bientôt.
Mais luit encor son aile ;
Tous les ors y chancellent
A séduire Watteau.
Une illusion l’irise,
Notre désir l’attise
Une dernière fois
Pour fondre à mon regard
Qui a senti trop tard
Passer l’ultime joie.
La nouvelle est plus ronde
Et plus lourde, on dirait.
Suspendue comme un monde
A quelque dieu distrait,
Elle titube, lente.
Tous les angles l’aimantent
Qu’elle frôle sans voir…
Ma prière la guide et ne respire plus…
Mais elle tombe enfin, trop imbue de sa gloire,
Comme un fruit éclatant et de soleil repus.
Vois sa dansante fille
Qui se moque déjà
En cueillant des myrtilles
Sur le bout de mes doigts.
Le heurt d’une corolle
La tuerait comme on joue.
Mais elle est trop frivole
Pour penser à tout.
Gronde donc cette folle
Insoucieuse du sort
Qui fait la farandole
Et butine sa mort.
Mais quel courant l’enlève
A notre inquiétude ?
La nue soudain se lève
Et savamment élude
Ce grelot si ténu.
Où donc, dis, où es-tu,
Caprice de lumière,
Toi que je préférais,
O toi qui le savais ?
Hélène Aribaut
Toulouse 19 Avril 1965
Si vous aimez, ne le gardez pas pour vous !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 15:59
Une seule larme
Dans mon étang
Et toute la nuit
La lune s’y voit ridée
O
Une allumette brève
pour ta route de nuit
Je ne vends pas je te la donne
Un poème
O
La tragédie sied à la jeunesse
Quand jeunesse est passée
l'humour
est vêture exquise
O
Tu as raison
grâce est donnée
selon toi
par qui ?
O
Quand de force
La chair s’humilie
L’âme aussi
Doit se faire douce
O
L’éphémère se dit
Mourir ne m’effraie pas
j'ai déjà de vieux os
O
Ma pauvre herbe est flétrie
Mais un baiser de Dieu
Et elle resplendira
O
N'éteins pas la lampe
A quoi bon ?
Entends cliquer le morse
Il faut obéir
O
La lune est ronde enfin
sur son étang
Mais la grenouille
ne dormira plus
O
Hélène ARIBAUT
30 Janvier 2001
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:00
Les orgues construisaient l'édifice
de l'éternité en surplis
les doigts croisés selon le rite
Je fixais le brun doré des boiseries liturgiques
et du pot-au-feu familial
avec leurs pâles yeux de cire et de graisse
qui moiraient la lumière
Parfois l'homme parlait,
patriarche, devin, poète,
et je croyais
j'étais petite fille
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:02Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 08:21
Tout le monde connaît l'histoire du vilain petit canard. On sait quelles furent ses souffrances tant qu'on le crut et qu'il se crut un canard mal fait. On sait aussi à quel point il s'efforçait de vivre comme tous les canards, et même de devenir un joli canard, afin d'obtenir l'amour de chacun. Sa mère disait de lui : " C'est mon enfant aussi." Cet aussi lui perçait le coeur, et il eût préféré qu'elle ne dît rien.
Quand il lui fut révélé qu'il n'était pas un canard mais un cygne, l'un de ces beaux oiseaux blancs qu'il avait admirés de loin et enviés, il ne se tint plus de joie et oublia les douleurs passées. Il pardonna de bon coeur à tous ceux qui l'avaient persécuté par ignorance, et crut qu'il allait désormais être heureux.
C'est là qu'Andersen s'est arrêté. Comme d'autres histoires s'arrêtent au moment où les gens s'embrassent, où ils s'épousent, où ils ont beaucoup d'enfants. Sur un bon moment, là où l'on est en droit de supposer que tout va aller bien. Tout le monde est content, le lecteur à qui l'on donne l'espoir de bien "finir" sa propre histoire, et qui en supporte mieux les vicissitudes, l'auteur qui s'est fait plaisir, et tous ceux qui ne lisent pas mais à qui les lecteurs transmettent leur optimisme.
La vie, elle, ne s'arrête jamais, ni sur un bon ni sur un mauvais moment. Elle continue seulement, aveugle et puissante comme un fleuve.
Le vilain petit canard fut emporté par elle. Il fut donc cygne, un cygne très ordinaire, aussi beau que tous les cygnes, sauvages surtout. Il respira à sa mesure, s'éprit de liberté et de grands espaces, mena la vie normale de son espèce. Mais, de même qu'il n'avait pas été un canard comme les autres, il ne fut pas non plus un cygne tout à fait semblable aux autres cygnes. Ceux-ci ne s'interrogeaient jamais sur eux-mêmes, sur leur beauté, leur liberté, la force prodigieuse de leurs ailes qui pouvaient les emporter si haut, si loin. Ils ne ressentaient nul privilège et jugeaient que leur belle vie leur était due. Notre cygne au contraire, qui se souvenait d'avoir été canard, parce qu'il avait durant son enfance été traité comme tel, goûtait avidement chacun des plaisirs qui lui étaient donnés, en rendait grâce, s'extasiait. Et puis, il lui était resté de sa petite enfance une sensibilité très vive, accrue encore par les mauvais traitements, et sous les plumes éclatantes de blancheur, sous les ailes puissantes qui l'enlevaient, grelottait une âme malingre et souffreteuse, craintive toujours, comme si son bonheur était usurpé et pouvait sans préavis lui être ôté. Ce n'était pas pourtant un bonheur bien scandaleux, il n'était pas un bien grand cygne, et il avait bien mérité un peu de calme et de réjouissance. Mais il avait une mémoire précise et une conscience exigeante. Il se rappelait ses frères qui barbotaient toujours dans le vivier au fond du jardin, qui enfonçaient leurs palmes dans les crottes de la basse-cour et se querellaient pour une tête d'anguille. Il avait oublié leur méchanceté à son égard. Il pensait à sa mère qui avait eu pour lui des élans d'affection car il nageait bien.
Il lui prit l'envie de les revoir. Il pensait, en sa naïveté, que sa mère serait fière de le voir devenu si beau, si grand. Elle l'avait couvé, élevé, c'était sa mère. Il entreprit un long voyage à sa recherche. En chemin, il rencontra des cygnes domestiques qui mendiaient des croûtons dans les canaux mal tenus d'un jardin public, et apprit que le sort des cygnes n'est pas nécessairement enviable. Il fut tenté de partager leur vie, par humilité et compassion, en souvenir de ses frères canards. Mais le goût de l'espace l'emporta et il reprit son vol.
Il finit par retrouver sa famille. Comme l'enfant prodigue, qu'il n'était pas, il s'imaginait de chaudes retrouvailles, sa mère attendrie et fière, ses frères et sœurs plus sages et mieux intentionnés. Mais quand, passée la première frayeur de ce grand oiseau s'abattant au milieu de la basse-cour, les canards surent à qui ils avaient affaire, ils ne firent qu'envelopper d'hypocrisie leur sotte envie et leur rancune. Sa mère lui fit beaucoup de compliments et le montra partout. Il raconta ses voyages, décrivit des pays, des moeurs. On ne lui pardonna point d'être si intéressant. Il croyait vivre là, du moins quelques temps, mais on lui fit comprendre qu'il n'avait pas sa place, qu'il ne l'avait jamais eue, d'ailleurs. Sa mère elle-même se mit à lui décocher de ces petites flèches qui ne blessent pas ouvertement et dont on ne peut faire état. Elle lui vantait les mérites de toutes ses couvées de canards et, quoi qu'il fît ou dît, ne fît pas ou ne dît pas, il eut toujours tort.
Il s'en alla, aussi tristement que la première fois. Il connut de nouveau l'ivresse de l'altitude, la volupté de s'appuyer sur la toile du vent, de glisser dans les airs en embrassant des plaines et des montagnes, de mirer le soleil sur son plumage blanc, et bien d'autres joies encore que les cygnes sont seuls à connaître. Mais toujours, toujours lui resta cette tristesse, cette amertume, cette souffrance d'enfance dont on ne peut guérir.
Quand il mourut, il chanta comme on dit que chantent les cygnes. Ceux qui l'entendirent frissonnèrent. Ils se demandaient où cet oiseau qu'ils supposaient heureux avait bien pu puiser cette science de la douleur. Ils ignoraient que tous les cygnes ont d'abord pataugé dans la mare aux canards, qu'ils ont désiré ardemment s'élever dans les nues et que, lorsqu'ils ont réussi à s'alléger enfin pour s'envoler, ils se sentent bien seuls et n'ont de cesse qu'ils n'aient fait venir auprès d'eux toutes les canes, tous les canards et canetons d'autrefois, tous les vilains petits cygnes qui eux aussi crient leur solitude et leur soif de paradis.
Hélène Aribaut
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:04
La musique s’infiltre en toi comme un poison en redessinant toutes tes arborescences. Elle se met à t’habiter toute et se loge à l’aise en étirant tes parois.
Tu n’as plus qu’à t’en aller à la recherche d’une autre maison.
Mais il est déjà trop tard, il n’y a plus d’issue – tu es prisonnière – que dans l’encens qui monte de la cheminée, mais c’est un bras que la musique allonge pour saisir les nuages, et le bras reste attaché au corps qui t’a dévorée. Tu demeures, nulle et entière, dans les viscères chauds de la musique, tu te laisses rouler dans des sécrétions délicieuses que tu ne comprends pas.
Si tu risques un œil à un orifice, tu n’aperçois qu’un monde ennuyeux et importun que tu annihiles d’un tour de clef avant de te retourner vers les chœurs ivres du dedans, et te tenir au bord de l’entonnoir tourbillonnant qui va t’aspirer, t’avaler, te dissoudre dans la musique, la bienheureuse folie
« …ertrinken,
versinken –
unbewusst –
höchste Lust » ! *
Hélène Aribaut
Bonnieux, La Colombine, 24 Novembre 198O
* « …se perdre, s’éteindre – sans pensée – pure joie ! »
Derniers mots d’Isolde dans Tristan de R. Wagner.
O
La nuit tombe brusquement en même temps que la fatigue te jette sur ton lit, mais le vice du dire va l’emporter encore sur le sommeil, et tu allumes ta lampe qui est dehors une veilleuse sous un voile au milieu des champs de novembre. Et tandis que l’homme qui, là-bas, vient de faire taire son tracteur à la fin des heures de labour, s’imagine que tu reposes, paresseuse, en ta maison, tu comptes dans tes os ton travail et ton usure, toutes les douleurs avivées par l’effort sur ton clavier, par ton ascèse musicale, et encore après par la volonté d’extirper de toi la parole qui t’étrangle, de délivrer un peu de ce dire compressé qui te fait mal, de griffer le papier de ces mots indigents, face à l’opulente foule qui voudrait se faire jour et rompre tes barrages. Fatigue, fatigue, après ce que j’ai entrevu, je ne puis croire que tu sois autre chose qu’un provisoire empêchement, l’atermoiement cruel du donneur de cadeau qui n’en finit pas de froisser le papier, de dénouer les rubans d’un présent fabuleux.
La vraie santé n’est pas d’ici, je m’impatiente de l’attendre. Chaque moment de force et de gloire est suivi de rechute. Le poète s’alite et le musicien, pour le moment, ne s’émerveille que de balbutiements. La joie se consomme elle-même et balaie toute tentative de se chanter, de s’enfermer dans un livre qu’on garde. A l’excès de la joie répond le mutisme et le désir de fermer les yeux pour la rêver, la mort, rêve choisi qui ne prend jamais fin…
Hélène Aribaut
Bonnieux, la Colombine, 24 nov.
publié dans ENCRES VIVES n° 97
Août-sept. Oct. 1981
O
Trop tard, trop tard la musique lui déclara son amour et se mit à la visiter, à lui manger ses heures. Elle s’éveillait fatiguée, triste parfois, mais la mémoire de la musique soudain s’éveillait en elle à son tour, se dressait sur son séant, joyeuse d’une journée qui s’ouvrait. La veille était née une nouvelle fois une Bagatelle de Beethoven, et on allait courir se pencher sur le clavier, sur son berceau. Les doigts impatients titubaient un peu sous l’ivresse qu’ils allumaient eux-mêmes. Les ballerines s'ébrouaient dans un gai désordre, l’orchestre s’accordait et tout à coup le soleil se levait au-dessus du piano béant et derrière le rideau, là derrière où tremble une primevère en pot, rose, tendre, à la merci d’une soif trop longue. Et la musique souveraine balayait tout de sa traîne lente, et je n’étais que langue de sable vernie d’eau qui se laisse lécher et emplir par la mer. Et le délire s’emparait de mes mains, de ma tête et de mon corps qui dansait, tout le buste appuyé sur le pouce qui gronde et insiste, douloureux, tout le bras soulevant l’auriculaire afin qu’il ne pèse pas plus qu’une étamine, et ma tête qui tourne de l’alcool mêlé des mélodies. Et la fièvre me gagne. Mes mains sont chaudes à présent et déferlent. Une marée monte des noirs registres, s’égoutte un moment dans un medium oscillant et grimpe là-haut en courant dans les flaques de soleil d’où elle se jette en rideaux de perles.
Je m’en vais porter mes pas dans des contrées étranges. Chaque accord de lumière est si beau que je suspends ma jambe, je suspends mon souffle, les cils pris dans un fil de la vierge tendu sur mon chemin. Les parfums montent en même temps que le soleil et vous chavirent.
A la fin je m’abattrai avec le crépuscule, épuisée, tremblante et sans force pour faire parler d’autres voix. Les mots infirmes tentent de grotesques envols. L’aigle facile coule son ventre sur l’altitude, et je vois devantmoi la musique reculer toujours plus haut sa cime éblouie.
Hélène Aribaut
Bonnieux, la Colombine, 24 nov. 198O
Publié dans ENCRES VIVES n° 97
Août-sept. Oct. 1981
O
Une maladie dont on ne veut pas guérir, la musique comme l’amour te parle de forces vives plus colorées que la santé. Tout ce qui pousse dru en ce monde, tout ce qui jaillit, éclate et brûle, tout l’allant des hommes et tout ce qui va vite ressemble à la chétive racine qui pousse en rampant sa face livide vers le soupirail, à côté de ces voix venues d’un enviable ailleurs, à côté des couleurs refusées aux peintres, l’insoutenable blanc fait de la giration de toutes les couleurs, la vitesse si grande que nos yeux douloureux ne regardent que l’immobile lac à goût d’éternité. La toupie à peine se déhanche pour qu’on la voie tourner, fond les couleurs peintes sur ses flancs en un lasso de lumière. Et la musique te cingle avec une violence que tu n’oublieras pas ; tu voudras encore souffrir de ce mal-là, tu regretteras cette sensation d’impuissance et de faiblesse extrême comme si, avec tout ton corps pesant, affamé, maladif, toute ta chair palpable, tu te retrouvais cheveu dans la paume d’une main que tu ne perçois pas, délestée de toi-même, souffle, pur esprit, inconsistante voix se mêlant à l’orchestre du monde, piccolo dérisoire et ténu autour de qui pourtant se taisent de temps en temps les cordes et les cuivres.
Hélène Aribaut
Bonnieux, La Colombine, 24 Nov. 1980
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:06
EPITAPHE POUR SAINTE-VICTOIRE
Montagne mon amie ma complice
où j'ai guetté le miracle de chaque matin
Depuis sept ans tu es mon horizon
Allumée de rose tu m'invitais à vivre
Je t'ai vue poudrée de mauve dans la brume
Une écharpe de cygne au cou
Incendiée d'amour au couchant
Tragique sous l'orage
Etincelante sous la neige
Disparue dans l'averse
Tes rochers présentaient leurs faces à la lumière
et faisaient bouger tes reliefs
La couleur des forêts débordait de ses lignes
et tu t'ombrais comme une femme
Une joie m'est arrivée
Tu souriais à mon bonheur
Tu l'accueillais parfois dans la bénédiction
de tes parfums
Puis un malheur m'advint
Et tu dressais toujours ton vaisseau pour me dire :
"Vois comme je suis belle et comme je dure !
Ne te soucie donc pas d'un nuage qui passe"
Je me suis mise à attendre
Tu étais devenue un autel pour mes prières
Je te volais des portraits avec mon appareil et mes pinceaux
En aurore et en pluie, en bleu, en vert, en ocre rose,
en lie-de-vin, en noir et blanc,
en vapeur blanche et en esprit,
grande dame en toutes toilettes
le symbole de l'immuable
dans le mouvement des saisons
dans les caprices de lumière
JE T'AI VUE NUE, DANS LE MISTRAL,
FENDRE L'AZUR COMME UN COUTEAU
Ils t'ont brûlée
ILS T'ONT MISE AU BUCHER
COMME JADIS LES SORCIERES
Ils t'ont brûlée
Et te voici, sépia et noir,
endeuillée de toi-même
Nous contemplons le désastre
de ta pâleur mortelle
de tes bois calcinés
Nous respirons l'âcre odeur de la mort
Nous retenons notre souffle comme
sur un champ de bataille
après que les derniers râles se soient tus
accablés par un sentiment d'irrémédiable
Il est venu pour toi, le temps de peine
Tu pleures tes arbres, moi mes amours
Pourtant, rocher, tu demeures
et te dresses contre le vent
Et je te regarde toujours
Et l'espoir ne veut pas mourir
Sous tes cendres bat le coeur
de la vie obstinée
Ils n'ont pu t'avilir
Ils ont coupé ta chevelure
Ils t'ont dépouillée de tes vêtements
Ils t'ont saccagée
Mais ils ne peuvent rien contre ton âme
Ils passeront
Et toi
TU REFLEURIRAS
Ton souffle
dans tes arbres, dans tes parfums,
dans le bruissement des insectes
caressera nos visages
Nous te gravirons encore en nous tenant par la main
Et dans la gloire du sommet
nous regarderons
DE L'AUTRE COTE
Hélène Aribaut
Fuveau, le 13 Septembre 1989.
Publié dans Créart, la même année.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:08
Epitaphe pour un bon larron
Toi qui toujours marchais de garrigue en ramures,
Toi qu’on n’attachait pas longtemps entre des murs,
Qui sellais ta moto, lavé de matin pur,
Ton ancien corps est là, sous cette lourde pierre.
Sans yeux pour tes amis, sans ouïr leur prière.
Avec les autres morts sous le béton obscur.
Mais ton âme est ailleurs, bien vivante et légère
En haut d’une colline, entre thym et bruyère.
De ta pipe elle monte, ainsi qu’une fumée
Qui vient, qui va, repart du ciel ou de la terre,
S’enroule autour d’un mont, demeure, hospitalière,
Complote une visite auprès de gens aimés.
Et dans leur cœur ils voient ta haute silhouette,
Tes doigts sur ta guitare emplumée de poète
Et de peintre de Chine, à l’encre et en points noirs.
Ils entendent ta voix sonore, et ton rire,
Ton prélude au piano, la rivière où tu mires
Tes messages d’amour, la rage d’un espoir.
Tu es parti bien tôt pour la mort buissonnière,
Comme le fit Brassens il y a vingt ans : naguère !
Mon prince, souviens-toi de ta dame, jadis.
Aujourd’hui elle est là, qui ne rit ni ne pleure,
Laisse son cœur ouvert chaque jour, à toute heure,
Ecoutant le hautbois et le De profundis.
Priant le Seigneur pour ton âme mécréante,
Mais si remplie d’amour, d’humour, et pas méchante,
Plaidant de ta bonté, de la guerre et du feu.
Et Lui énumérant tous tes actes fidèles
Afin qu’Il ait pitié, et te donne des ailes,
T’accueille en Sa maison et t’ouvre tous Ses lieux :
Des bois de châtaigniers, des jardins, la musique,
Des chemins dans le temps, les langues archaïques,
Des villes rose et or, de toulousains couchants,
Des soleils africains, des tables provençales,
Des Paris oubliés, navires et escales,
Des gares d’Italie, des France d’artisans.
Et puis une oasis, une cruche d’eau claire,
Un désert somptueux, une borie de pierres,
Là où tu lui fixas son lointain rendez-vous.
Te rende enfin un corps que l’amour transfigure.
L’oiseau de ce matin en a été l’augure.
Elle Lui dit : « Mon Dieu, je me mets à genoux. »
Elle Lui dit : « Mon Dieu, ressuscitez cet homme.
Sa belle voix saura Vous composer des psaumes.
Il ne fut à personne. Il est déjà à Vous. »
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:11
Esprit, si tu pouvais me porter assez haut
Vers ta montagne ensoleillée, aride et sainte,
Et faire éclore là mon poème, ma plainte
Maîtrisée en quatrains et tercets assez beaux
En pétales ardents et fiers, d’un bleu nouveau,
Pour me faire oublier l’amère vie éteinte,
La douleur cramponnée toujours, ma force feinte,
Mon sourire le jour, et la nuit mon sanglot
Si je pouvais passer l’automne pourrissant
En une seule nuit, un songe si puissant
Qu’il me déposerait soudain à ma fenêtre,
Un matin de printemps où je pourrais renaître
Jeune et renouvelée, dans un exquis bien-être,
Dans la grâce étonnée au milieu des encens !
Hélène Aribaut
Fuveau, 28 Novembre 2002
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:12
Le bédouin
Par défi, par résignation, allonge les étapes sans boire.
Ses bêtes sont efflanquées,
Toutes en pattes et en arrogance.
Lui-même est sec, fait d’ombres verticales,
Un pli orgueilleux à la lèvre.
Son turban poussiéreux montre encore
Quelques fils d’or éteint dans son tissage.
Voici une oasis
La rare concession d’un rêve
Où il se passe peu mais fort
Il se contente d’allonger la main
Sur le caillou rond d’une épaule
Qu’il a beaucoup désirée.
Il rêve d’un autre rêve où
Il se souvenait d’une nuit d’amour
Qui n’eut jamais lieu peut-être.
Sous ses haillons bat le cœur
Du tout-puissant imaginaire.
Sur son visage
les larmes d’expériences illusoires
Ont fait leurs ravins.
Il repart rassasié
Voile indigo
Brume de sable
Sur les échasses de son esprit
Comme une gigantesque sauterelle.
H.A.6 Juin 1989.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:14
Si je t'aime
Je serai ce chien irritant qui te suit
et qu’un jour méchant tu renvoies d’un coup de pied
Il gémit, incrédule,
et s’en revient sur tes talons
et puis gambade devant toi
t’invite au jeu, à la promenade
Il n’a pas oublié
qu’un autre jour de misère
où il aboyait, l’écume aux lèvres,
où il défendait ton approche d’un regard menaçant
tu es venu à lui
tu t’es accroupi
tu as fouillé sa fourrure
en murmurant une litanie bête et douce
tu as trouvé sa blessure et tu l’as pansé
tu lui as installé une litière près de ton feu
et lui as dit des mots plus brûlants que les flammes
qui lui ont guéri le cœur
Depuis, à jamais attaché à tes pas
il supporte tes mauvais traitements
car il sait
que tu es un aveugle qui marche
Si je t’aime
Je serai ce jardinier inlassable
penché sur un arbrisseau malade
Tout le monde lui dit qu’il n’a qu’à l’arracher
Mais lui
Il ramollit la terre autour de la tige
comme on fait gonfler un oreiller
il gratte du doigt la lèpre du tronc malade
il lave feuille par feuille
il arrose doucement
et il regarde son arbre
en lui parlant peut-être
Patience après patience
il verra les branches se redresser
les mauvaises feuilles tomber
et poindre à leur place
de petits embryons verts
C’est que la sève, en bas,
Aura fini par l’entendre
Et haussera la tête vers son baiser
Si je t’aime
Je serai une femme dont le sang coule
ponctuel
pour que coule la vie
Je serai une femme lovée sur la douleur de son ventre
une femme écartelée par la vie neuve qui sort d’elle
une femme aux seins lourds et gercés
qui se donne à manger
au petit enfant goulu
une femme présente
attentive à tes besoins
veilleuse de ta fièvre
bondissante au milieu de la nuit
parce que ta plainte murmurée
a trouvé son oreille au plus profond
au plus lointain, au plus délicieux de son sommeil
Je souffre trop pour t’écouter
Tu m’exaspères avec ton museau humide sur mes mollets
avec ta fidélité stupide
et tu me donnes envie de te battre
Tu perds ton temps avec ton arrosoir
Tu peux même m’inonder de tes larmes
je ne pousserai plus
je ne vivrai plus
C’est trop difficile de lutter chaque jour
contre le vent, contre le froid et contre les chenilles
pour un hypothétique bouton que le gel brûlera
pour un hypothétique fruit où le ver se mettra
Et puis regarde-moi
Es-tu sûr que je ne suis pas une herbe vilaine ?
Qui t’a dit que je pourrais devenir grand et te donner de l’ombre ?
Qui t’a raconté la sornette d’un fruit lourd et doré
suave à ton palais
soufflé comme une bulle
de la maigre sarbacane de ma branche ?
Et pourquoi tant de soins, ma mère ?
Je n’ai pas demandé à venir
Il faisait doux et chaud dans les limbes
Tu m’as jeté dans ce monde froid
dans cette lumière crue
dans ce monde cruel
et ma première inspiration a été une brûlure
Qu’adviendra-t-il de moi ?
Serai-je une fille parturiente comme toi
une femme qui s’use au service d’une famille ?
Serai-je un fils que la vie accablera bien des fois
et peut-être un homme qu’on jettera dans le charnier d’une guerre ?
Oui, mais pour moi, le chien, qu’elle est belle,
la promenade du matin dans la colline
dans les parfums nouveaux de l’aube
dans la lumière bien lavée des premiers rayons
lorsque je jappe d’allégresse
et offre à ta paume la soie floche de mon col !
Comme brille ta feuille qui tremble dans le vent
lorsque je renverse la tête sous tes ramures déployées
quand tu as enfin consenti à grandir, mon arbre !
Comme elle fond sous ma langue
la chair satinée de ta pêche
comme se froisse sous ma dent la pruine et le velours de ta peau !
Et comme tu es beau à regarder, mon enfant,
lorsque tu cours dans le soleil
l’œil brillant, la joue animée,
comme elle est douce, la musique de ta voix
comme elle est chaude, l’écharpe de tes bras
lorsque tu l’enroules autour de moi
Comme la vie est dure
Comme la vie est bonne
Et comme elle a raison de s’obstiner !
Hélène Aribaut
Fuveau, fin 1987 ou début 1988.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:15
Pourquoi ne peut-on demeurer
sur les sommets rocheux
les champs de fleurs
les neiges éternelles
ou bien dans les grands fonds marins
où bougent les coraux
aux étages de la paix inaltérable ?
Pourquoi faut-il que la vie
cruellement nous repousse
vers les vallées enfumées
vers les vallées de larmes
nous rejette à la crête
des vagues et des tempêtes
dans la mousse salie
des débris de batailles ?
Pourquoi, pourquoi tarder
à nous appeler
aux félicités promises ?
Hélène Aribaut
Fuveau, 11 Août 1987.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Blagassou le 11 Octobre 2014 à 16:17
Poète, tu es celui qui ne veut pas tenir de place.
Petit lit dans la chambre trop peuplée
Silence de la lecture
Plus tard silence de l’amour.
Tu as croisé des gens tonitruants
Qui n’ont jamais douté de leur légitimité
Qui exigent et qui puent en toute souveraineté.
Tu as choisi le livre le plus dépenaillé
Sans couverture ni nom d’auteur
Et en as fait ta Brocéliande.
Tu t’es fabriqué des disques de carton
Que tu faisais jouer dans ta tête capitonnée.
Tu as déroulé, entre deux bâtons,
Des cinémas peints sur cellophane.
Tu as fait tenir ta littérature
Sur des bouts de papier
De petits carnets grignotés sur la vie que d’autres te prenaient.
Tu t’es laissé envahir par ce que d’autres construisaient.
Mais enfin !
Quand vas-tu oser ?
Ose la tendresse de ton regard sur le monde
Ose tes images.
Ose ta musique.
Mêle ta voix aux chœurs des prophètes
De ceux qui voient et disent
Avant que demain advienne.
Le Haïku est miette
Que seul l’oiseau convoite.
Offre aux hommes la moisson abondante
Que leurs yeux atrophiés ne peuvent percevoir.
Illumine pour eux des champs
Dresse des arbres et des montagnes
Fais rugir le tonnerre.
Garde pour Dieu la simple goutte
Où tremblent des mondes.
Hélène Aribaut
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique